« Je veux que nos enfants soient fiers ! » Entretien avec Fatou Keïta

Depuis Le Petit garçon bleu, son premier album publié en 1995, l’Ivoirienne Fatou Keïta n’a cessé de traiter de la question de la différence. Comment appartenir au groupe tout en restant soi-même ? Et si la réponse passait par le rire ? Livre après livre, cette grande figure de la littérature jeunesse africaine écrit des histoires pour que les petits Africains soient fiers de leur patrimoine culturel et de leur peau « couleur chocolat ».
Taina Tervonen : Comment vous est venue l’envie d’écrire ?
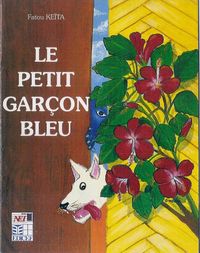 Fatou Keïta : J’ai toujours aimé lire et écrire ! À l’école, j’aimais les rédactions. Enfant, je vivais à Bordeaux, j’ai lu tous les classiques occidentaux. L’envie de raconter des histoires est donc venue tout naturellement. Quand mes propres enfants étaient petits, je leur inventais des histoires, pour les calmer quand ils pleuraient, pour les faire manger… Je crois que j’ai vraiment ça dans le sang !
Fatou Keïta : J’ai toujours aimé lire et écrire ! À l’école, j’aimais les rédactions. Enfant, je vivais à Bordeaux, j’ai lu tous les classiques occidentaux. L’envie de raconter des histoires est donc venue tout naturellement. Quand mes propres enfants étaient petits, je leur inventais des histoires, pour les calmer quand ils pleuraient, pour les faire manger… Je crois que j’ai vraiment ça dans le sang !
J’avais commencé à écrire Le Petit garçon bleu depuis quelque temps déjà quand j’ai vu une annonce pour un concours d’histoires pour enfants, dans un journal. C’était organisé par ce qui, à l’époque, s’appelaient l’ACCT et qui désormais s’appelle l’Organisation Internationale de la Francophonie1. J’ai finalisé mon texte que j’ai présenté avec une autre histoire, La Voleuse de sourires. J’ai eu les deux premiers prix. Ça m’a ouvert les portes des maisons d’édition. C’est comme ça que l’aventure a commencé – et je l’ai continuée !
Ces deux livres ont été publiés très rapidement.
Le Petit garçon bleu a fait tout de suite l’unanimité. C’est mon livre fétiche – je ne dis pas « livre préféré » parce qu’on ne dit pas ça d’un de ses enfants ! Aujourd’hui, il est au programme de CE2 en Côte-d’Ivoire. Il a été traduit en anglais et en allemand2, et a eu plusieurs éditions, avec des illustrateurs différents3. Aujourd’hui, j’aurais très envie d’en faire un dessin animé !
Vous avez une production très nourrie, un album par an, au moins. Comment arrivez-vous à tenir ce rythme ?
Les histoires pour enfants, j’en ai plein la tête ! Si mon éditeur arrivait à suivre, j’en publierais certainement plus ! Mais comme je ne dessine pas moi-même, je suis tributaire du travail des illustrateurs. Certains sont rapides, d’autres moins. J’assure le suivi moi-même : le découpage, la maquette… Les illustrations sont très importantes, il faut que texte et image fonctionnent ensemble. Quand vous racontez une histoire à un enfant qui ne sait pas lire, vous l’avez sur vos genoux et vous lui montrez les images – si vous parlez d’un chapeau rouge et qu’il n’est pas sur l’image, il vous posera la question tout de suite : « Il est où le chapeau rouge ? »
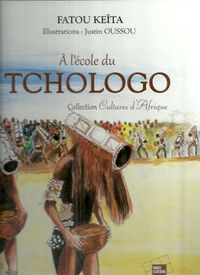 Vous avez travaillé avec des illustrateurs aux styles très différents : les dessins proches de la caricature de Lassane Zohoré, la peinture de Kyoko Dufaux, les couleurs très vives de Claire Mobio… Comment se passe le choix de l’illustrateur ?
Vous avez travaillé avec des illustrateurs aux styles très différents : les dessins proches de la caricature de Lassane Zohoré, la peinture de Kyoko Dufaux, les couleurs très vives de Claire Mobio… Comment se passe le choix de l’illustrateur ?
Je choisis moi-même les illustrateurs, en fonction de l’histoire. Parfois, il faut faire des essais. Par exemple, pour Le Loup du Petit Chaperon rouge en Afrique, j’avais demandé des planches à Kyoko Dufaux dont j’aime beaucoup le travail, mais elle n’arrivait pas à donner aux animaux les expressions que je souhaitais. C’est finalement Lassane Zohoré qui a illustré cet album, avec un loup très, très expressif ! D’un autre côté, je ne confierais pas à Zohoré les mêmes textes qu’à Kyoko Dufaux…
Pour À l’école du Tchologo, j’ai travaillé avec un peintre qui n’avait jamais fait de livre jeunesse auparavant. Ce n’était pas facile ! Les premières planches ne me convenaient pas du tout, et ce n’était pas évident de lui expliquer ce que je voulais. Puis un jour, il est venu me dire qu’il était allé dans une librairie, qu’il avait regardé des livres pour enfants, et qu’il avait compris… Le résultat est un livre magnifique !
Dans cet album, À l’école du Tchologo, vous abordez un genre différent : le documentaire.
Ce livre inaugure une collection qui s’appelle Cultures d’Afrique, dans laquelle je voudrais faire le tour de la Côte-d’Ivoire et d’autres pays africains pour raconter différentes traditions et rites. Un deuxième album est d’ailleurs paru, L’Abissa, qui raconte une cérémonie du Sud de la Côte-d’Ivoire. Je veux immortaliser dans des livres ces rites qui tendent à disparaître. Aujourd’hui, il y a la modernité, les enfants vont à l’école… Certaines de ces traditions risquent vraiment de se perdre.
Vous pensez que ce travail de transmission et de mémoire est une mission de la littérature jeunesse ?
Oui, je pense que c’est très important. Nos enfants des villes ne connaissent rien aux traditions. Je suis allée récemment au Nord de la Côte-d’Ivoire avec ma petite-fille de huit ans. Elle était émerveillée, elle ne connaissait rien au village. Je lui ai montré un arbre en lui disant : « Tu as vu le manguier ? » Elle m’a répondu : « Mais comment tu sais que c’est un manguier ? » Quand j’ai raconté l’échange aux gens de la région, tout le monde a éclaté de rire ! Ils n’en revenaient pas que cette petite fille de la ville ne connaisse pas le manguier. C’est vous dire… Alors a fortiori les traditions, les rites initiatiques… !
Dans vos albums, vous évoquez ces deux univers : le village et la ville. Vous abordez également les tensions qu’il peut y avoir entre ces deux mondes.
J’essaie de réhabiliter le village. Je voudrais effacer l’image négative qu’il évoque : on dit que c’est la brousse, que les gens n’y connaissent rien… Dans Le Boubou du Père Noël, je mets en scène le Père Noël qui arrive en Afrique, et je voulais que l’image soit très jolie, je voulais vraiment un joli petit village au clair de lune, et que le Père Noël arrive en disant : « Oh, que c’est beau ! » Dans cet album, je voulais aussi réhabiliter le boubou africain – c’est une belle tenue, et une tenue intelligente parce que l’air passe dedans. Le Père Noël qui arrive avec son gros manteau et ses bottes manque de s’évanouir de chaleur, et il est sauvé par un boubou africain. Ces livres, c’est pour rappeler aux petits Africains des villes que le village, c’est beau. Il faut respecter les gens, leur manière de vivre et d’être. Ils ne sont pas moins importants parce qu’ils vivent au village.
Une thématique revient souvent dans vos livres : la différence.
C’est un thème qui me touche profondément, parce que pour moi, c’est du vécu. J’ai un frère handicapé qui est décédé l’année dernière. Nous étions très proches. Il a vécu dans son fauteuil roulant et nous avons vécu son handicap : le regard des autres, le rejet. Lui-même s’est confié une fois à ma fille en disant que dans sa vie, le plus difficile avait été le mépris, surtout de la part des Africains. Il avait vécu en Europe et en Afrique. Il disait que les Africains n’ont pas le respect de la personne handicapée. Pour eux, c’est un être inutile. C’est une réalité.
Quand j’étais jeune fille, j’ai travaillé dans un camp de vacances aux États-Unis, où on s’occupait de handicapés mentaux. Au début, j’en avais peur, comme tout le monde. Mais j’ai appris à être avec eux. Puis Dieu a fait qu’aujourd’hui je m’occupe d’une petite-nièce qui est infirme moteur cérébral. À sept ans, elle ne marche pas, ne s’assied pas, ne parle pas. Elle a été complètement abandonnée par ses parents, je m’en occupe avec ma mère.
Donc, le handicap, je connais, j’ai vécu avec. C’est plus fort que moi, ça revient dans mes livres.
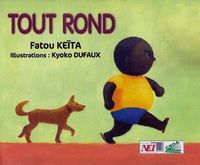 Vous traitez la question de la différence aussi d’une manière très précise qui est de questionner la place de l’individu dans le groupe : comment faire partie de la communauté tout en restant qui on est ?
Vous traitez la question de la différence aussi d’une manière très précise qui est de questionner la place de l’individu dans le groupe : comment faire partie de la communauté tout en restant qui on est ?
Les gens jugent par les apparences. Mais être beau, c’est simplement un plus que la nature nous a donné. Ce n’est pas tout, loin de là. Quand quelqu’un est beau et qu’il est méchant, il devient vilain. Alors que quand quelqu’un est gros, pas beau, et qu’il est gentil et chaleureux, il devient beau et on l’aime. C’est surtout cette idée que je veux faire passer, dans Tout Rond par exemple où le personnage est un petit garçon rondouillard. Je ne vais pas le faire maigrir pour qu’on l’aime. Il est gros et on doit l’aimer tel qu’il est. Lui-même doit s’aimer et s’assumer tel qu’il est. Ça s’apprend, par le rire notamment.
Justement, vous utilisez très souvent le rire et l’humour, comme une issue possible des conflits.
Oui, je trouve que le sourire est quelque chose d’extraordinaire ! Dans tous les pays du monde, ça existe, ce même mouvement, cette même expression. Le rire, le sourire, c’est magique. C’est quelque chose qu’on peut partager, c’est un langage universel qui ouvre beaucoup de portes.
Vous avez mentionné Le Loup du Petit chaperon rouge en Afrique et Le Boubou du Père Noël. Je pense aussi au Petit cheval de Dalarna. Ce sont toutes des histoires qui mettent en scène le lien entre l’Europe et l’Afrique.
Pour moi, les livres sont des ponts entre les continents. Dans les livres occidentaux, on voit souvent le Blanc qui vient à la découverte de l’Afrique… Je voulais le faire autrement. Le Petit cheval de Dalarna, c’est aussi l’histoire d’un retour chez soi. Découvrir, ça ne veut pas dire se débarrasser de sa propre culture. Revenir chez soi, ça fait plaisir aussi.
Enfant, vous lisiez de la littérature occidentale. Qu’est-ce que vous gardez de cette expérience de lecture, dans un univers purement occidental, en tant qu’enfant africain ?
C’est vrai que j’ai été nourrie à la littérature occidentale. Je ne me souviens pas avoir eu entre les mains un livre africain, je ne sais même pas s’il en existait un à l’époque. Un livre entièrement avec des personnages noirs, je n’en ai jamais vu, enfant. Bon, ça ne m’a pas détruite – la preuve, c’est que j’écris aujourd’hui ! Mais quand même, je trouve que ça manque.
C’est donc important pour moi, dans la littérature que je veux offrir aux enfants du monde entier, de réhabiliter la couleur noire qui véhicule encore trop de connotations négatives, trop de racisme. C’est pour ça que je dis : « des enfants à la peau couleur chocolat ». J’essaie vraiment de mettre ça : « couleur chocolat », parce que les enfants en général aiment le chocolat, ça les fait sourire, ce n’est pas péjoratif, c’est gentil. Par exemple, le loup dit qu’il va aller en Afrique parce que là-bas il y a des enfants « avec la belle peau couleur chocolat » !
Je veux qu’en ouvrant le livre, un petit Noir puisse s’y reconnaître. Je veux que nos enfants soient fiers, qu’ils puissent avoir des livres intéressants et beaux entre les mains, qui leur parlent d’eux. Je suis aussi très fière que mes livres voyagent, qu’ils aillent en Europe et aux États-Unis, parce que ça veut dire que de petits Blancs vont les ouvrir et découvrir des personnages qui sont tout à fait comme eux, qui réagissent comme eux – sauf qu’ils ont la peau couleur chocolat. Je veux que les enfants l’acceptent, qu’ils sachent que la couleur de la peau, on ne l’a pas demandée, on est comme on est. Et notre peau est très jolie !
Je veux aussi que l’Afrique soit fière de montrer ses livres. C’est pour ça que je suis très exigeante avec mes éditeurs. Je veux de beaux livres qui puissent voyager et concurrencer les livres européens.
Vous avez aussi fait des livres-CD.
C’est le cas dans mes derniers albums. Le texte est lu et accompagné d’une musique de kora ou de tambours. Certains textes sont aussi lus en dioula, la langue la plus connue en Côte-d’Ivoire, et j’en suis très fière ! Il me semblait plus porteur d’avoir un CD audio en dioula plutôt que de traduire et d’imprimer le texte dans une édition bilingue. C’est très bien, mais qui lit les éditions bilingues ? Qui a été éduqué pour lire et écrire dans les langues africaines ? Alors qu’un CD, on peut le faire écouter aux enfants, et leur montrer les images. J’ai fait cette traduction avec des amis qui maîtrisent bien la langue. Moi je n’ai pas grandi avec le dioula, je le comprends, mais je ne le parle pas bien.
Vous avez écrit aussi des livres pour adultes.
Mon premier roman, Rebelle4, traitait de l’excision. J’ai assisté à une conférence sur le sujet, où j’entendais dire que les intellectuels africains ne prenaient pas position, qu’ils voulaient en protéger leurs propres filles mais ne faisaient rien de plus. Ça m’a interpellée. Je ne suis pas essayiste, j’aime raconter. Donc j’ai décidé de raconter une histoire pour montrer que j’étais viscéralement contre. C’est comme ça que le livre est né. Le roman montre les problèmes de la femme africaine, le combat contre l’excision. Souvent, ces sujets sont abordés de l’extérieur avec une vision occidentale : regardez comment les Africains sont méchants, est-ce qu’ils aiment vraiment leurs enfants, et ainsi de suite. Je voulais raconter tout ça de l’intérieur, dire qu’une maman qui fait exciser sa fille ne pense pas qu’elle va la faire charcuter. Elle se dit avant tout que son enfant doit faire partie de la communauté, être acceptée. C’est un problème difficile et délicat. Je voulais en parler d’une façon positive, à travers le combat du personnage principal. Je voulais aussi dire que les politiques doivent s’en mêler pour arrêter cette horreur.
C’est comme ça que je me suis prise au jeu, et que j’ai commencé à écrire un autre roman, Et l’aube se leva5. C’est toujours l’histoire d’une femme – ce n’est pas autobiographique, mais il y a beaucoup de moi dans la manière de voir les choses, de parler des injustices. Il faudrait enfin reconnaître qu’on vit dans un monde très inégal, où beaucoup d’avantages sont pour les hommes. C’est une réalité. Les femmes travaillent d’une façon incroyable en Afrique, mais personne n’en parle. Moi, je dis qu’on devrait payer une femme trois ou quatre fois plus qu’un homme, parce qu’elle travaille trois ou quatre fois plus qu’un homme !
 Vous abordez la question de l’inégalité entre hommes et femmes, filles et garçons, aussi dans certains de vos albums.
Vous abordez la question de l’inégalité entre hommes et femmes, filles et garçons, aussi dans certains de vos albums.
Je l’évoque dans Tiratou la petite guenon. Le personnage principal, une petite guenon, va montrer qu’elle aussi peut courir vite et faire des choses comme les garçons. Un autre livre qui en parle est Kadjolian la petite mécano6. Quand je montre la couverture aux enfants, je leur demande si ça leur semble normal, une fille mécanicienne. La plupart me dit que non. Je demande pourquoi. Ils me disent qu’une fille, ça ne sait pas réparer des voitures. On discute, ils finissent par comprendre que si.
Les filles s’autocensurent, aussi. Récemment j’étais dans une école au Burkina, et j’ai eu les larmes aux yeux : les filles étaient tellement timides, elles me regardaient avec admiration, elles étaient surprises de voir une femme comme moi. Quand je leur demandais si une fille pouvait être mécano, elles disaient que non. Je leur ai demandé ce que les filles font, elles m’ont dit que les filles font le ménage et la cuisine, qu’elles vont au marché. Je leur ai parlé de moi, de mon travail, du fait que je voyage… et j’étais contente de voir cette petite flamme, cette petite fierté dans les yeux après qu’elles m’aient rencontrée.
Cela fait vingt ans que vous publiez des albums jeunesse. Quel regard portez-vous sur l’évolution de la littérature jeunesse africaine ?
De plus en plus d’auteurs se risquent à écrire pour les enfants. Certains pensent que c’est facile mais ce n’est pas si évident. Il faut bien connaître les enfants. En Côte-d’Ivoire, nous avons quelques noms qui commencent à produire de plus en plus, au Sénégal et au Burkina aussi. C’est un marché porteur qui s’ouvre, et les éditeurs l’ont compris. Les livres se vendent bien, malgré tout ce qu’on dit.
La distribution reste cependant le maillon faible. Je suis toujours en train de pester parce que mes livres ne sont pas vendus en France par exemple. Même en Côte-d’Ivoire, mes livres ne sont pas toujours en rayon. Et à l’international, c’est la catastrophe.
Et vous, toujours autant d’histoires à raconter ?
Oui ! J’ai encore plein d’histoires à raconter ! Mais mon grand rêve, c’est de faire des films d’animation avec toutes ces histoires déjà publiées…
Notes et références
1. L’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) est l’ancien nom de l’actuelle Organisation Internationale de la Francophonie, OIF. †
2. Fatou Keita, ill. Clare Menck, trad. Adrian Murphy,The Little Blue Boy. Heinemann, 1998. Ill. Olivia Aloisi, trad. Yvonne Lüssi, Der kleine blaue Junge. KiK-Verband, 1999. †
3. Fatou Keïta, Le Petit garçon bleu. Ill. Taofik Atoro. Cotonou, Editions du Flamboyant, 1995 et 1999. Ill. Claire Mobio. Abidjan : Nouvelles Editions Ivoiriennes : Vanves : Edicef, 1996. Ill. Kyoko Dufaux. Abidjan : NEI - Nouvelles éditions Ivoiriennes, 2011. †
4. Nouvelles éditions ivoiriennes, 1998. †
5. Présence africaine, 2006. †
6. Kadjolian, la petite mécano. Ill. Abraham Niamien. Abidjan : Fratmat 2013. Avec CD. †
Pour aller plus loin
Fatou Keïta
Fatou Keïta est l’auteur de 22 livres pour enfants, dont le premier a paru en 1995 – voir sa bibliographie dans en cliquant sur "Côte-d'Ivoire" dans la Carte de la littérature africaine francophone pour la jeunesse. La grande majorité a été publié par les Nouvelles éditions ivoiriennes ; certains ont été plusieurs fois réédités. Le grand succès de ses livres auprès des enfants dépasse largement la Côte-d’Ivoire ; ils ont reçu de nombreux prix ivoiriens et internationaux. Fatou Keïta enseigne la littérature anglaise à l’Université de Cocody à Abidjan. On peut consulter son site Internet.
 Taina Tervonen
Taina Tervonen
Journaliste indépendante, Taina Tervonen a collaboré pendant dix ans à la revue Africultures, en assurant le suivi de l'actualité littéraire africaine, en réalisant des entretiens avec des auteurs ainsi que des dossiers thématiques, dont des dossiers sur la littérature jeunesse. Elle a également écrit des ouvrages et des films documentaires, qu’elle a réalisés. Aujourd'hui, elle travaille pour la presse finlandaise et francophone, souvent sur des enquêtes au long cours, et collabore avec la Revue dessinée.






