Des bulles en créole ? Rencontre croisée avec les éditeurs de Caraïbéditions (Guadeloupe) et Epsilon (La Réunion)
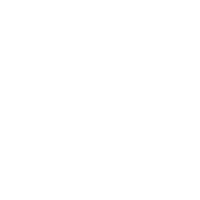
Astérix est parmi les livres les plus traduits au monde. Les aventures du héros du petit village gaulois sont accessibles dans cent sept langues, dont vingt langues des régions de France… Mais d’autres titres de la bande dessinée franco-belge connaissent d’impressionnants succès dans le monde tels Tintin, Titeuf, ou encore, Lucky Luke…
Depuis 2008, ce sont deux éditeurs de l’Outre-mer, Caraïbéditions aux Antilles et Epsilon à La Réunion qui se sont lancés dans la traduction en différents créoles (antillais, réunionnais, mauricien) de quelques titres de ces séries.
En marge de ce mouvement de traduction, ces deux éditeurs proposent aussi quelques créations originales, en français cette fois, et insufflent une belle vitalité au genre de la bande dessinée dans les îles.
Florent Charbonnier et Éric Robin se sont prêtés au jeu de cet entretien croisé pour expliquer leur politique éditoriale.
Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Florent Charbonnier : Je suis éditeur. J’ai quarante-deux ans. Je vis aux Antilles depuis quinze ans, entre la Guadeloupe et la Martinique. J’ai créé ma maison d’édition, Caraïbéditions, il y a quatre ans. Auparavant, j’étais directeur et gérant de concessions automobiles, ce qui m’a permis d’envisager l’édition, non pas seulement comme un passionné – j’ai la passion du livre depuis toujours –, mais aussi en tant que gestionnaire. Si le livre est un produit noble, je l’ai abordé en prenant immédiatement en compte les questions commerciales, de distribution et de promotion. Ma connaissance des réseaux de distribution et des mentalités aux Antilles m’a aidé à me lancer.
Éric Robin : Je suis né en 1961, en région parisienne, à Argenteuil, de parents bretons. Après des études de gestion à l’université de Paris-Dauphine, j’ai démarré mon activité professionnelle au sein du groupe Havas, en menant des études de marché pour l’implantation de bornes interactives et en créant des maquettes d’annuaires papier et électroniques pour les Pages jaunes. J’y ai fait la connaissance du tout premier modèle Mac et des logiciels de mise en pages. C’était avant Internet, à l’époque de la préhistoire microinformatique ! Parisien pur jus, je ne connaissais absolument pas La Réunion. L’envie de vivre « ailleurs » et une petite annonce pour un poste chez un imprimeur à La Réunion ont concrétisé l’affaire. C’était il y a vingt ans tout juste. À La Réunion, j’ai exercé plusieurs métiers : dans une imprimerie, dans une entreprise de pré-presse, à la rédaction d’un magazine (un bimestriel « touristique » nommé Plein Sud). C’est là, sur le terrain, au sein de cette rédaction, que j’ai appris le métier d’éditeur. Merci à Roland Ginet, le fondateur de Plein Sud.
Pourquoi avoir créé une maison d’édition ? Pourquoi publier des bandes dessinées ?
Florent Charbonnier : Mes parents étaient enseignants, j’ai baigné dans les livres. Je ne pensais pas un jour vivre de cette passion, mais les Antillais sont très cultivés et un peu coupés de tout par l’éloignement, donc j’ai réalisé petit à petit, lors d’échanges avec différents libraires de la place, qu’il y avait des attentes, des besoins d’ouvrages qui n’existaient pas forcément aux Antilles ou à la Réunion. Tous mes auteurs ont un lien avec la Caraïbe, tous les ouvrages aussi, comme le nom de la maison l’indique, un nom un peu « bateau » mais dont on se souvient, alors que je rêvais d’un nom plus poétique… Caraïbéditions a trois axes éditoriaux : la bande dessinée, le roman policier et la réédition d’œuvres littéraires célèbres.
Eric Robin : J’ai créé Epsilon multimédia après sept années de présence à La Réunion, en 1997. L’activité consistait à réaliser des sites web et des bornes multimédia. Mais, bien vite, la passion du livre a refait surface et j’ai peu à peu orienté l’activité d’Epsilon vers l’édition : tout d’abord en co-éditant avec Fabienne Jonca Du bonheur dans votre assiette, un livre de cuisine réunionnaise signé Brigitte Grondin (32000 exemplaires vendus depuis 1998) ; puis, à partir de 2005, en multipliant la parution d’albums jeunesse et de bandes dessinées. Aujourd’hui, l’activité est intégralement tournée vers le livre. Pourquoi la bande dessinée ? Tout simplement parce que c’est en dessinant des planches de bandes dessinées et en vendant des dessins de presse que j’ai gagné ma vie pendant mon service militaire. En éditant des bandes dessinées, je deviens un « auteur par procuration » !
Comment organisez-vous votre diffusion et votre distribution ?
Florent Charbonnier : On est distribué par un distributeur métropolitain, Daudin, qui est bien implanté, ce qui facilite les démarches des libraires. Mais je m’occupe moi-même de la diffusion. Je préfère être dans moins de librairies, mais bien ciblées, que dans beaucoup qui vont engendrer des retours et des difficultés à gérer. Nous sommes référencés sur les sites d’Amazone, de Chapitre, dans les FNAC, dans un réseau de librairies spécialisées BD (Canal BD), dans les librairies fréquentées par les communautés afro-antillaises à Paris (L’Harmattan, Anibwé, Présence africaine…). La plus grosse partie du chiffre d’affaires se fait dans les Départements d’Outre-Mer.
Eric Robin : À la Réunion, nous diffusons et distribuons nous-mêmes nos ouvrages en librairie et dans les points de vente touristiques. Pour les GMS (grandes et moyennes surfaces), nous faisons appel à un professionnel de la distribution en grandes surfaces : l’ARDP. Pour la Métropole, la Suisse et la Belgique, la diffusion et la distribution des bandes dessinées sont entre les mains de Makassar, dont c’est la spécialité. Pour les autres livres (jeunesse, cuisine, nature, romans) c’est la mission de Rue Bleue, du groupe Arcadès.
 Quelles sont les créations les plus emblématiques de votre ligne éditoriale en matière de bandes dessinées ?
Quelles sont les créations les plus emblématiques de votre ligne éditoriale en matière de bandes dessinées ?
Florent Charbonnier : Nous avons publié « le premier manga antillais », L’Île du vent, qui n’a de manga que la forme. Pour sa structure narrative, on est plus proche de la BD franco-belge. Le thème est l’émigration clandestine des Haïtiens, à laquelle sont confrontés aujourd’hui les Guadeloupéens et les Martiniquais. On y aborde tous les problèmes de la société contemporaine aux Antilles, les problèmes de classes sociales, les békés1, l’ésotérisme, la religion… ce qui permet aux lecteurs métropolitains de découvrir les Antilles. C’est écrit par Hector Poulet, grand chantre du créole aux Antilles. Hélas, je n’ai trouvé aucun dessinateur sur place qui maîtrise la technique du manga, alors qu’il y a beaucoup de talents ici, mais dans d’autres techniques. Je me suis adressé à une illustratrice métropolitaine, Élodie Koeger, qui est venue ici en résidence d’auteur pendant six mois.
Par ailleurs, on vient de lancer notre première bande dessinée sur l’histoire de l’esclavage. L’auteur est africain, Serge Diantantu, et la publication est patronnée par l’Unesco. On vient aussi de publier une bande dessinée sur le chevalier de Saint-Georges avec Roland Monpierre. Il y pas mal de choses dans les tuyaux en terme de création !
 Eric Robin : J’ai beaucoup de tendresse pour la série Nèfsèt Kat de Fabrice Urbatro. L’action se passe de nos jours dans un village des Hauts de la Réunion. On y montre une Réunion moderne, très éloignée des clichés touristiques. C’est une Réunion « de l’intérieur », avec en toile de fond, les mutations urbaines et sociales que connaît l’île depuis vingt ans. J’aime aussi éditer des albums humoristiques, destinés aux jeunes ou aux adolescents. L’île au temps suspendu de Lou Lubie et Romain-M est une fantaisie ayant pour terrain de jeu une ville de Saint-Denis un peu onirique où le temps est resté bloqué à 7h du matin. Enfin, Caribobèche de Pécontal et Tolliam met en scène une grand-mère Kal totalement déjantée. Ces trois productions sont les tout premiers albums de ces auteurs…
Eric Robin : J’ai beaucoup de tendresse pour la série Nèfsèt Kat de Fabrice Urbatro. L’action se passe de nos jours dans un village des Hauts de la Réunion. On y montre une Réunion moderne, très éloignée des clichés touristiques. C’est une Réunion « de l’intérieur », avec en toile de fond, les mutations urbaines et sociales que connaît l’île depuis vingt ans. J’aime aussi éditer des albums humoristiques, destinés aux jeunes ou aux adolescents. L’île au temps suspendu de Lou Lubie et Romain-M est une fantaisie ayant pour terrain de jeu une ville de Saint-Denis un peu onirique où le temps est resté bloqué à 7h du matin. Enfin, Caribobèche de Pécontal et Tolliam met en scène une grand-mère Kal totalement déjantée. Ces trois productions sont les tout premiers albums de ces auteurs…
Pourquoi avez-vous décidé de traduire des classiques de la bande dessinée, comme Lucky Luke, Tintin… ?
Florent Charbonnier : Je n’ai pas réinventé le fil à couper le beurre, la bande dessinée en langue régionale existe dans presque tous les pays européens depuis quarante ans. J’avais constaté, il y a très longtemps, qu’Astérix, Tintin ou d’autres, avaient été publiés dans des dizaines et des dizaines de langues et de dialectes, mais pas en créole. Le créole, contrairement au chti, au basque, au breton, est utilisé dans nos îles, tous les jours, tout le temps, en famille, dans les magasins, dans l’entreprise parfois. Alors, autant commencer par une publication qui va marquer et faire connaître la maison. Je me suis renseigné auprès des libraires pour savoir quelle était la bande dessinée la plus appréciée ici, ils m’ont dit que c’était Astérix, qui est, du reste, la bande dessinée la plus vendue au monde, avec quatre cent millions d’exemplaires vendus environ. C’est aussi la bande dessinée dont les droits coûtent le plus cher sur le marché…
 Eric Robin : C’est en Bretagne, en feuilletant un Tintin en gallo2, que m’est venue l’idée d’une adaptation de Tintin en créole réunionnais. Et comme j’étais sur le chemin d’Angoulême, j’en ai parlé aux représentants de Casterman, qui ont été séduits par l’idée. Entre-temps, j’ai appris que Caraïbéditions publiait Astérix en créole antillais. L’année 2008 a vu sortir ces deux séries à peu près en même temps. Il faut croire que c’était dans l’air du temps… Nous avons sorti simultanément deux titres deTintin en créole réunionnais : Tintin péi Tibé et Le Kofré bijou la Kastafiore. L’accueil a été phénoménal.
Eric Robin : C’est en Bretagne, en feuilletant un Tintin en gallo2, que m’est venue l’idée d’une adaptation de Tintin en créole réunionnais. Et comme j’étais sur le chemin d’Angoulême, j’en ai parlé aux représentants de Casterman, qui ont été séduits par l’idée. Entre-temps, j’ai appris que Caraïbéditions publiait Astérix en créole antillais. L’année 2008 a vu sortir ces deux séries à peu près en même temps. Il faut croire que c’était dans l’air du temps… Nous avons sorti simultanément deux titres deTintin en créole réunionnais : Tintin péi Tibé et Le Kofré bijou la Kastafiore. L’accueil a été phénoménal.
Sur un plan plus général, publier des bandes dessinées classiques en créole nous paraissait logique. Il s’agissait d’installer le genre sur un moyen terme et de contribuer – très modestement, bien sûr – à la fixation du créole dans l’écrit. Cela peut paraître très pompeux… En même temps, les traducteurs font un travail formidable de sauvegarde du patrimoine linguistique réunionnais. J’ai bien peur que cette langue (ce patois comme on l’entend parfois) soit en voie d’affaiblissement. C’est pour cela qu’il faut la fixer dans des livres, même s’il ne s’agit « que » de bande dessinée, un genre littéraire qui ne fait pas l’unanimité.
Avez-vous eu des difficultés à acquérir ces droits ?
Florent Charbonnier : J’ai fait un pari. L’entreprise est un pari et, dans l’édition, toute publication est un pari. J’ai pris des risques. Personne n’avait osé les prendre avant pour le créole dans la bande dessinée. L’ouvrage a été très bien reçu par les médias, par les libraires, par les lecteurs, c’est l’ouvrage le plus vendu aux Antilles. Nous avons alors eu les droits pour le créole de la Réunion. Ensuite, nous avons acquis les droits pour Tintin aux Antilles et pour Titeuf aux Antilles et à La Réunion.
Eric Robin : Je n’ai eu aucune difficulté à acquérir les droits.
Comment choisissez-vous les albums que vous allez traduire ?
 Florent Charbonnier : Le Grand Fossé, premier titre réalisé par Uderzo seul, une allégorie sur la chute du mur de Berlin, était un titre parfait pour les Antilles. C’est l’histoire d’un village gaulois coupé en deux. Chaque moitié fait la guerre à l’autre et Astérix va permettre la réunification du village. Ce thème m’a permis de surmonter un problème qui est celui du créole : les créoles de la Guadeloupe et de la Martinique ne sont pas identiques, même s’ils ont un tronc commun à 90 %. Un projet de traduction comme celui-là n’est pas rentable pour une île seulement, il fallait pouvoir mélanger les deux créoles pour avoir une cible plus importante. Alors, la moitié du village parle le créole de Guadeloupe et l’autre moitié le créole de Martinique et comme il y a une rivalité entre les îles, les gens adorent et on apprend plein de choses sur la différence entre les deux créoles.
Florent Charbonnier : Le Grand Fossé, premier titre réalisé par Uderzo seul, une allégorie sur la chute du mur de Berlin, était un titre parfait pour les Antilles. C’est l’histoire d’un village gaulois coupé en deux. Chaque moitié fait la guerre à l’autre et Astérix va permettre la réunification du village. Ce thème m’a permis de surmonter un problème qui est celui du créole : les créoles de la Guadeloupe et de la Martinique ne sont pas identiques, même s’ils ont un tronc commun à 90 %. Un projet de traduction comme celui-là n’est pas rentable pour une île seulement, il fallait pouvoir mélanger les deux créoles pour avoir une cible plus importante. Alors, la moitié du village parle le créole de Guadeloupe et l’autre moitié le créole de Martinique et comme il y a une rivalité entre les îles, les gens adorent et on apprend plein de choses sur la différence entre les deux créoles.
 Eric Robin : Le premier critère est totalement subjectif : Z comme Zorglub est un album de Franquin qui me tient particulièrement à cœur. En l’éditant, j’ai imaginé qu’il ne rencontrerait pas le succès d’un Lucky Luke, car il est peu connu, surtout des jeunes générations. C’est aussi un album très bavard. Mais peu importe, il « fallait » le faire paraître en créole. Ensuite, si nous voulons que les albums soient achetés et lus, il est nécessaire de s’appuyer sur des séries populaires et consensuelles. C’est un marché tout neuf. Nous avons donc édité d’autres séries : Tintin, Lucky Luke, Spirou, Boule et Bill, Gaston… D’autres sont prévues (Les Bidochon, par exemple). Nous éditons aussi des albums jeunesse originaux, entièrement en créole ou bilingues. Si le public suit, nous continuerons.
Eric Robin : Le premier critère est totalement subjectif : Z comme Zorglub est un album de Franquin qui me tient particulièrement à cœur. En l’éditant, j’ai imaginé qu’il ne rencontrerait pas le succès d’un Lucky Luke, car il est peu connu, surtout des jeunes générations. C’est aussi un album très bavard. Mais peu importe, il « fallait » le faire paraître en créole. Ensuite, si nous voulons que les albums soient achetés et lus, il est nécessaire de s’appuyer sur des séries populaires et consensuelles. C’est un marché tout neuf. Nous avons donc édité d’autres séries : Tintin, Lucky Luke, Spirou, Boule et Bill, Gaston… D’autres sont prévues (Les Bidochon, par exemple). Nous éditons aussi des albums jeunesse originaux, entièrement en créole ou bilingues. Si le public suit, nous continuerons.
Quels sont vos tirages en BD ?
Florent Charbonnier : Pour Astérix, on a dépassé les 15 000 exemplaires, tirage à 6 000, réimprimé deux fois. Les autres en sont loin. Pour les Antillais, s’agissant d’Astérix, comme du Petit Prince, ce sont des livres qu’on se doit d’avoir dans sa bibliothèque. Mais on a aussi envie d’y voir nos propres créations !
Eric Robin : Passé l’effet de surprise de 2008 (7 500 exemplaires pour chacun des deux premiers Tintin, 2 x 5 000 exemplaires pour le premier tirage, puis 2 x 2 500 dans le mois qui a suivi), nous nous sommes installés sur un tirage variant entre 2 000 et 3 000 exemplaires selon les albums. Nous pensons produire environ quatre albums par an. Plutôt que de réimprimer, nous allons privilégier la multiplication des titres. Mais je tiens à dire que nous éditons également des albums de BD d’auteurs réunionnais, souvent leur premier d’ailleurs, et que je suis très fier de contribuer à leur démarrage dans le métier d’auteur de bande dessinée. Paradoxalement, ces « BD-pays » sont publiées en français et non pas en créole.
Est-ce que les gens lisent vraiment en créole ?
Florent Charbonnier : Beaucoup de gens trouvent que c’est difficile de comprendre le créole à l’écrit, qu’il faut le verbaliser. Le créole est une langue orale, et, comme pour toutes les langues régionales, les gens le parlent mais ne le lisent pas. Nous avons dû traduire un autre titre d’Astérix en créole de la Réunion, car la problématique du Grand Fossé n’existait pas là-bas.
Mais lire en créole est amusant. Certains s’en servent dans leur enseignement, car le créole est enseigné dès le primaire et jusqu’à la faculté, même en Métropole dans trois académies. Il y a un CAPES de créole. Cela nous oblige à un travail très sérieux sur la langue.
Pour La Réunion, quel créole choisissez-vous ?
Eric Robin : Chaque série est entre les mains d’un auteur reconnu localement, qui s’entoure de l’équipe de son choix : Robert Gauvin pour Tintin, André Payet pour Tintin et Spirou, Teddy Iafare-Gangama pour Le Petit Spirou et Lucky Luke, Anny Grondin pour Boule et Bill et Gaston, Axel Gauvin pour Les Bidochon. Chaque traducteur pratique « son » créole, en fonction de ses origines géographiques ou sociales. Environ un quart de la production quitte La Réunion dans les mains des Réunionnais qui voyagent ou dans celles des touristes.
Vous inscrivez-vous dans l’esprit militant et revendicatif des années 1980 qui avaient vu de nombreuses publications en créole ?
Florent Charbonnier : J’ai choisi volontairement des traducteurs qui ne se servent pas de la langue comme d’une arme. Je m’entoure de gens qui ne sont pas dans des querelles de clochers, qui ne se serviront pas de nos livres comme porte-étendard de leur cause. On a la chance de ne pas avoir aux Antilles de conflit sur les différentes graphies du créole comme à la Réunion. Hector Poulet, avec qui je travaille, est pour que le créole vive et il pense qu’il faut qu’une langue régionale dépasse les frontières de sa région, sorte de son île pour continuer à vivre. La diaspora antillaise et guyanaise achète notre production en Métropole et nous vendons aussi aux collectionneurs qui, dans le monde entier, veulent toutes les versions du Petit Prince principalement et d’une façon moindre, d’Astérix, de Tintin.
Eric Robin : Cela correspond évidemment à une demande, une demande identitaire forte. Mais il ne faut pas ignorer les réactions de rejet qui sont parfois violentes. Certains Réunionnais considèrent l’exercice comme inutile, voire dangereux, pour l’avenir de nos marmailles. Selon eux, le créole doit rester cantonné à l’intimité de la sphère privée, il nuirait à l’apprentissage et à la bonne pratique du français, qui seul peut ouvrir au monde. Ce n’est évidemment pas mon point de vue. Il me semble que si on est à l’aise avec sa langue maternelle, on le sera d’autant plus avec d’autres langues. Il s’agit plutôt de défendre une spécificité. Nos albums se veulent populaires et à la portée de tous. D’où des compromis en terme de graphie : il faut être lu par le plus de lecteurs possible !
 Quels sont les difficultés majeures de la traduction vers le créole ?
Quels sont les difficultés majeures de la traduction vers le créole ?
Florent Charbonnier : Pour Astérix, par exemple, c’est, bien sûr, de traduire tous ces jeux de mots, ces calembours. Hector Poulet a parfois passé des jours sur une expression. Il faut garder l’humour et c’est ce qui est le plus difficile. Pour Titeuf, j’ai eu une idée qui a créé le buzz six mois avant la sortie. Nos traducteurs, qui ont plus de cinquante ans, tournaient en rond, car Titeuf parle un français de cour d’école et nos traducteurs ne connaissaient pas ce créole qui évolue très vite. C’est une langue vivante et très imagée. Nous sommes allés dans des écoles primaires pour le recueillir. Pour chaque mot ou expression on demandait aux enfants, ils donnaient leur traduction, on notait. Vous connaissez l’amour des enfants pour Titeuf, ils étaient ravis. L’album est sorti en même temps en Métropole et aux Antilles. Dans les librairies, il y avait une pile en créole, une pile en français. Ce qui est amusant, c’est que de nombreux adultes ont acheté Titeuf pour apprendre le créole que parlent leurs enfants.
Eric Robin : Il me semble que l’on peut tout traduire en créole, y compris des modes d’emploi, s’il le fallait. Il ne faut pas se contenter de faire du régionalisme. La difficulté majeure réside dans le choix d’une graphie. Je pourrais vous en parler pendant des heures, bien que je ne sois pas créolophone et encore moins linguiste. Mais je suis à bonne école ! Entre les graphies privilégiant l’étymologie (proches du français, pour faire simple) et les graphies phonologiques (basées sur les phonèmes, avec abondance de k, de w et de z), il faut faire des compromis. Tant que le créole ne sera pas enseigné et fixé dans sa forme écrite, des difficultés de lecture persisteront...
Notes et références
1. Descendants des colons.†
2. Le gallo désigne la langue romane de Haute Bretagne, distincte du breton.†
Pour aller plus loin
Caraïbéditions. [Consulté le 10.03.2011]
Site de l’éditeur.
Epsilon éditions. [Consulté le 10.03.2011]
Site de l’éditeur.






