L’Harmattan, éditeur et libraire hors normes
Entretien avec Denis Pryen, fondateur et directeur
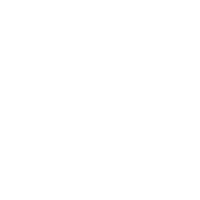
L’éditeur qui a publié le plus de livres de jeunesse (soit cinquante-cinq) en langues africaines (pas moins de dix-sept) se trouve… à Paris. Ces langues ont une belle place dans un catalogue d’ouvrages bilingues où d’autres langues dites « minoritaires » du monde entier (dont le créole, le kabyle…) sont largement représentées.
Si L’Harmattan est surtout un éditeur de sciences humaines, il a toujours publié pour la jeunesse : documentaires, romans, bandes dessinées, ouvrages écrits par des jeunes en atelier d’écriture et, tout particulièrement, des textes issus de la tradition orale. L’offre en contes est véritablement pléthorique avec les collections « Contes et légendes des mondes » et « Contes des quatre vents » dont Takam Tikou s’est souvent fait l’écho.
Un catalogue de 35 000 titres, une plateforme de prêt numérique, des éditions réalisées en Afrique, des librairies en France et dans dix pays africains, le tout sans subventions : comment est-ce possible ? Grâce à des pratiques éditoriales atypiques dans le paysage français, tant sur les modes de fabrication que sur les rapports avec les auteurs. Des pratiques qui ont souvent agacé, mais qui se sont avérées efficaces, non seulement pour l’édition en langues mais aussi pour que des milliers d’auteurs voient leurs livres publiés, référencés et distribués.
Denis Pryen, fondateur de la maison et son directeur pendant trente-cinq ans – il a confié désormais la direction à son neveu, Xavier Pryen –, nous a reçu dans son bureau de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, à quelques mètres de la librairie « historique » du 16 rue des Écoles, cette caverne d’Ali Baba où l’on trouve une importante sélection de livres africains pour la jeunesse, aussi foisonnante que surprenante.
Livres en langues
Pourquoi et comment les éditions L’Harmattan se sont-elles lancées dans la publication de titres bilingues pour les jeunes ?
L’Harmattan a été fondé en 1975 avec pour volonté, dès le départ, de s’intéresser aux autres cultures – Paris était alors une capitale africaine et latino-américaine grâce à l’immigration, et notre librairie du 16 rue des Écoles se situait au carrefour des cultures. Nous avons beaucoup travaillé avec des personnes issues de l’immigration et, en particulier, venant d’Afrique francophone ; les étudiants africains francophones étaient très nombreux en France dans les années 1975.
Très vite, nous avons aussi senti la nécessité de créer des supports pour que les enfants découvrent le bilinguisme à l’école. Nous avons alors travaillé avec les collèges et les crèches, afin de montrer aux enfants – y compris aux petits Français – que les autres cultures avaient aussi leur propre langue. C’est ainsi que nous avons créé la collection bilingue « Contes des quatre vents ». Elle est née d’une expérience en 1982-1983 au cours de laquelle nous avons accompagné trois classes dans la création de trois livres bilingues portugais-arabe, « Zac a dit »1 – une variante de « Jacques a dit ». Les parents ont écrit, à partir du français, les textes en arabe et en portugais. Et nous sommes partis à l’imprimerie avec les enfants, dans deux cars, pour qu’ils voient leur bouquin prendre corps. Cette collection a beaucoup marqué et on a pu sortir d’autres livres, en arabe-français, kabyle-français, ainsi que dans différentes langues africaines : swahili, kinyarwanda, wolof…2
Comment ces livres bilingues sont-ils diffusés ?
Tous ces livres ont été écrits et diffusés en France par le réseau des instituteurs : si ces instituteurs n’avaient pas été ouverts à cette question des langues, les livres n’auraient pas existé. D’autant que le réseau des libraires était très réservé par rapport aux livres bilingues : il faut en effet des parents très motivés pour acheter à leur enfant un livre bilingue. Depuis, la collection a fait son chemin ; les livres sont assez bien diffusés en Afrique, mais toujours en petite quantité, car le pouvoir d’achat en Afrique est très faible… Du point de vue de la rentabilité, les titres qui ont bien marché sont ceux en français-vietnamien, réalisés par Nguyên-Nga, et ceux en français-créole, signés par Isabelle Cadoré et son père, Henri – nous avons aussi publié du créole réunionnais, mais moins.
Pourquoi ce succès des livres en créole ?
La demande de livres en créole a été très forte, en métropole, avec les enfants des Antilles. Et là-bas, les libraires ont vraiment pris le relais : le grand public achète. On se souvient des débats des années 1975 autour de la langue avec La Langue créole, force jugulée de Dany Bebel-Gisler qu’on avait publié, ou bien, Du créole opprimé au créole libéré de France Aubert, ou encore, le travail de Jean Barnabé et de tous ceux qui ont surfé sur cette vague… Il continue à y avoir une demande, une vivacité du créole. De plus en plus, le créole a un statut de langue à part entière.
Dans vos livres bilingues français-créole, les auteurs, souvent, ne sont pas antillais… Pourquoi choisir de traduire leurs textes en créole ?
Parce que ces auteurs sont eux-mêmes proches des Antilles : Pierre Pinalie, auteur du Dictionnaire français-créole, n’est pas créole mais il a fait énormément pour le créole… Ce sont des auteurs qui ont un rapport vital à la langue locale. De même, pour le soutien aux langues africaines : on a souvent pour interlocuteur quelqu’un d’extérieur qui perçoit mieux la capacité des langues nationales à faciliter les apprentissages chez l’enfant. Localement, les parents préfèrent souvent le français, pensant qu’il va plus servir à leurs enfants…
Cependant l’enseignement en langues africaines semble revenir maintenant dans plusieurs pays…
Ces dernières années, notre collection de méthodes de langues « Parlons… » s’est développée fortement, après une période moins active ; elle compte aujourd’hui plus de 300 titres dont 60 sur les langues africaines. Nous encourageons maintenant nos auteurs à travailler dans les langues africaines les plus parlées pour publier des ouvrages scolaires et parascolaires. Car, en effet, la question de l’enseignement en langue nationale revient. On a demandé à nos dix structures africaines – dont certaines tournent très bien, comme en République démocratique du Congo, au Cameroun ou au Sénégal – d’être particulièrement vigilantes sur cette question. Il y a une quinzaine d’années, la coopération allemande m’a demandé de travailler sur l’environnement lettré3 des langues nationales : si on ne fait que du scolaire et du parascolaire, et qu’on ne donne pas à lire des histoires, des contes, des journaux, de la prose, de l’utilitaire dans la langue nationale, à quoi sert l’alphabétisation ? Nous avons toujours eu fortement à cœur cette préoccupation linguistique, et nous allons l’amplifier dans les deux ou trois années à venir.
Comment trouvez-vous vos auteurs ?
Il est difficile de trouver des ouvrages en langues. Beaucoup d’universitaires ont écrit des thèses, des mémoires, des ouvrages linguistiques assez théoriques, mais on les a peu sollicités pour des contributions concrètes. Il faut tout de même nuancer : au Burkina Faso et au Cameroun, quand j’ai travaillé pour les Allemands il y a quinze ans, j’ai trouvé énormément de brochures que l’on peut encore se procurer à la librairie. Mais, dans l’ensemble, il est très difficile d’obtenir des textes qui puissent aller jusqu’à une publication ; beaucoup d’entre eux ne sont pas aboutis.
Pour les collections « Contes des quatre vents » et « Contes et légendes des mondes », quand un auteur d’un pays nous présente un ouvrage, nous insistons pour le publier en bilingue – la demande vient de nous plus que des auteurs. C’est un pas difficile à franchir pour eux : ils ont peur d’enseigner aux enfants une langue qui va les enfermer, alors qu’eux sont arrivés à s’en sortir. Ils ne connaissent pas les résultats des études qui montrent que les gamins qui commencent par apprendre en langue nationale progressent plus vite dans les autres langues, alors qu’il y a tant de démarrages ratés en français. Même dans les coins où nous soutenons les écoles, par exemple, près de Dano au Burkina Faso, dans une zone rurale, la majorité des enfants qui passe en 6e ne sait pas faire une phrase correcte en français. Parmi ceux qui n’ont pas la chance de passer en 6e, les trois quarts retombent dans l’analphabétisme. Or, s’ils avaient appris leur langue, ce serait différent. Avec la fondation allemande Dreyer qui vient de créer une école maternelle extrêmement moderne où le dagara sera la langue d’enseignement de départ, nous allons publier des ouvrages, avec la difficulté que nous connaissons bien : il faut former les enseignants, qui eux-mêmes ne savent pas lire dans cette langue… Mais ça peut changer vite, en cinq ou six ans…
La méthodologie de L’Harmattan et l’édition africaine
Nous parlions des auteurs… Est-ce que L’Harmattan leur demande de participer aux frais d’édition de leurs livres ?
Pour toutes les collections jeunesse dirigées par Isabelle Cadoré, les auteurs ne participent pas aux frais et ils touchent des droits dès le début ; les illustrateurs reçoivent une somme forfaitaire ; et la maquette se fait en interne. Pour les thèses et la littérature dite difficile – comme un premier roman, par exemple –, la participation que l’on demande, en général, est de faire « le prêt-à-clicher », c’est-à-dire de nous remettre un manuscrit mis en pages aux normes typographiques (on forme les auteurs à le faire) et d’acheter cinquante exemplaires avec la remise libraire. En organisant une signature, ils vendent vingt à trente exemplaires, ils rentrent dans leurs frais et n’ont pas à courir après les subventions. Pourquoi réussit-on à publier actuellement 2 500 titres par an ? Parce que nous avons 400 directeurs de collection – certains font trois livres, d’autres cent – et parce que, tous les jours, nous recevons quarante manuscrits… Nous sortons plus de 1,2 million d’exemplaires imprimés par an !
Les gens ne connaissent pas notre « méthodologie » et ils ne comprennent pas pourquoi on a neuf locaux dans le quartier latin, pourquoi on a réussi à sauver le théâtre Le Lucernaire. Parce qu’on a une méthodologie sans subvention, avec une bonne rentabilisation, qui repose sur les gens et leur volonté de diffuser la culture. Et l’important, le capital humain, nous le formons concrètement, au plus proche des réalités économiques.
Quelle est votre stratégie pour les tirages ?
Dès 1984, nous n’avons pas eu peur de publier un livre à 400 exemplaires, si on savait qu’il n’en fallait pas plus pour le marché mondial. Nous produisions « en amalgame » par série de huit ou seize titres. Aujourd’hui, nous faisons des retirages à 3, 6, 10 exemplaires, s’il le faut.
Par ailleurs, on s’aperçoit que les titres les plus difficiles sont ceux qui se vendent le mieux par Internet. Amazon, qui représente 15 % de nos ventes en librairie, a pris nos 35 000 titres en magasin. Amazon est devenu notre client numéro un, bien avant la Fnac, bien avant Decitre. Quel est l’éditeur français qui, né en 1975, a 35 000 titres à son catalogue ? À l’époque, je me disais : « On aura un catalogue comme Cambridge, comme Oxford ». On l’a, et sur les thèmes les plus divers. Nos livres sont constamment demandés. Nous publions des témoignages qui apprennent autant aux gens sur l’anorexie, par exemple, qu’une étude scientifique : les deux sont nécessaires… Sans compter le nombre de colloques auxquels nos auteurs participent tous les jours… et le travail de nos 400 directeurs de collection.
Revenons à l’édition locale en langues : il existe des éditeurs qui ont des ouvrages prêts à imprimer mais qui n’y arrivent pas, faute de financement. Ce sont souvent des personnes compétentes en linguistique mais qui n’ont pas reçu une formation d’éditeur…
…ou qui n’ont pas eu la formation qu’il fallait en matière de gestion éditoriale, et ils attendent des subventions… Les personnes qui sont allées faire des formations en Afrique l’ont fait selon des critères qui ont mis les éditeurs sur une mauvaise pente. Ils les ont encouragés, par exemple, à imprimer localement : c’est une erreur monstre, vu que le papier, les machines et les encres sont importés, que le savoir-faire n’est pas au point, et que le coût de production est beaucoup plus cher que le coût du papier… Ces formateurs ont aussi affirmé qu’il fallait imprimer à 1 500 ou 2 000 exemplaires ! J’ai l’impression qu’on a tout fait pour nuire à la véritable naissance d’une édition indépendante. On a saupoudré les subventions pour tel ou tel livre, créant chez les éditeurs le réflexe de courir après l'argent… Notre méthodologie est aux antipodes : on ne court pas après les subventions, on tire à 200/ 300 exemplaires, et nos stocks ne nous coulent pas. On a essayé de nous barrer la route : la Société des gens « dits » de Lettres a essayé de nous bloquer à cause de nos contrats. On ne nous a jamais demandé de faire de la formation, alors que, à maintes reprises, j’ai montré l’aberration de ce qui était prôné. Les seuls qui ont compris et ont fait appel à nous pour des formations, c’est la GTZ4, la coopération allemande…
Pour revenir à votre question, nous imprimons pour les éditeurs qui le souhaitent. Nous le faisons pour La Sahélienne, au Mali, depuis un an et demi : nous avons passé un accord et l’éditeur s’en tire très bien. Nous tirons de petites quantités, 100 livres, et plus tard 100 autres, s’il le faut… Cela dit, la quadrichromie, souvent exigée pour le livre de jeunesse, est plus difficile… L’Harmattan Cameroun va produire plus de 100 titres cette année, mais ils avancent peu sur les livres de jeunesse, car ils en ont moins le savoir-faire. On va essayer de les former mieux, d’être plus attentif au secteur jeunesse qui est si important.
Le livre numérique
En préparant les bibliographies Afrique pour Takam Tikou, je constate qu’il n’y a guère que L’Harmattan qui propose ses livres en version numérique également…
L’Harmathèque, qui vend des e-books, lisibles aussi sur les tablettes, a déjà 25 000 titres : nous sommes le fonds francophone numéro un. Nous avons pu lancer L’Harmathèque du fait des techniques de publication mises au point. Aujourd’hui, nous sommes complètement autonomes et nous avons les moyens de nous développer. Nous proposons même à d’autres éditeurs, et surtout aux confrères africains, d’intégrer leurs fonds éditoriaux dans l’Harmathèque. Nous venons aussi de créer une section qui ne publie qu’en version numérique.
Quel est l’impact de votre plateforme numérique pour les bibliothèques ?
Il y a deux ans, nous avons fait une offre numérique aux bibliothèques françaises : cette offre n’a pas été comprise car, aujourd’hui, il ne faut pas avoir une bibliothèque numérique sur place dont on a le souci du stockage et du transfert… Le bibliothécaire doit orienter le lecteur vers un serveur unique. Par exemple, nombre de bibliothèques d’Amérique du Nord ont accès à nos ebooks via l’Harmathèque : ils ont tout compris. En France, on n’en est pas là, mais l’intérêt pour notre plateforme numérique (25 000 e-books, 17 000 e-articles, 250 vidéos, 600 programmes audio) est croissant. L’Organisation internationale de la francophonie a vu l’intérêt d’abonner à nos ebooks ses quarante-deux campus numériques sur les cinq continents5 dont vingt-trois se situent en Afrique subsaharienne. Si bien que, quand quelqu’un prépare une thèse, il peut travailler avec l’ensemble de nos ouvrages… Nous allons d’ailleurs lancer en octobre l’Université de la Paix avec des cours par Internet. Bien sûr, c’est encore très difficile pour l’Afrique et, dans les campus, j’ai vu la plupart des ordinateurs connectés pour du chat… Il faut maintenir le papier mais ça va évoluer très vite.
La distribution du livre de jeunesse en Afrique
Le livre de jeunesse marche-t-il en numérique ?
Pour l’instant, le livre de jeunesse reste encore, en gros, sur support papier. En Afrique, nous faisons partir dans nos structures tout livre avec 70 % de remise ; car, en bout de chaîne, un livre ne doit pas coûter plus de 50 % du prix en France – un prix à peu près abordable pour ceux qui ont l’habitude d’acheter un livre… Nous vendons, bien sûr, aussi les éditions locales. Et je rachète ici, d’occasion, des fonds d’éditeurs, notamment jeunesse, même en passant par des associations qui travaillent dans la récupération du livre, pour envoyer en Afrique des contingents de livres qui seront ensuite vendus dans nos librairies et ailleurs. Nous avons, par exemple, affrété un container de 22 000 livres pour une valeur de 20 000 euros destiné à l’association des libraires du Niger. Parce qu’il y a un manque de livres de jeunesse. Pour l’instant, nous envoyons des livres : au moins, nous savons qu’ils arrivent dans les mains des lecteurs.
Pourquoi avez-vous ouvert des librairies en Afrique ?
Nous avons attendu avant de nous implanter en Afrique. Nous n’avons commencé qu’il y a huit ou neuf ans. Avant, je ne voulais pas. Je préférais trouver des libraires locaux et leur faire 60 % de remise. Résultat, nos livres étaient vendus aussi chers qu’en France : personne n’a joué le jeu. La formation des libraires en Afrique, c’est comme celle des éditeurs : comment voulez-vous faire de la formation de libraires avec des formateurs qui souvent n’ont pas su tenir leur propre entreprise ? Quand nous avons voulu nous installer en Afrique, certains ont dit qu’on allait faire de la concurrence déloyale. L’important, c’est d e développer la lecture et la culture. Nous voulons créer des structures locales, de droit local, avec une économie locale.
Notes et références
1. "Le Château hanté", "Sidola" et "La Sorcière et la fleur" : contes écrits et illustrés par les enfants de l’école Jacques Prévert à Boissy-Saint-Léger. Zac a dit. Paris, L’Harmattan, 1984 (Contes des quatre vents). †
2. Langues d’Afrique subsaharienne et de l’océan Indien présentes dans le catalogue : wolof, mooré, malinké, mandingue, koalib, éwé, kabyè, bulu, duala, beembé, luo, kinyarwanda, kiswahili, shona, malgache, arabe tchadien, comorien. †
3. Un « environnement lettré » est « un environnement qui offre aux néoalphabètes de multiples occasions d’utiliser les connaissances qu’ils ont récemment acquises, de les renforcer par une éducation continue et de développer la ferme habitude d’apprendre tout au long de la vie ». Cf. Biennale de l'éducation en Afrique 2006. †
4. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, faisant partie depuis 2011 de la GTZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. †
5. http://foad.refer.org/article116.html †
Pour aller plus loin
Site des éditions L’Harmattan [consulté le 13.02.2012]
Le site de L’Harmattan permet la recherche, dans son catalogue jeunesse, parmi les ouvrages bilingues, ainsi que par type d’ouvrage et par zone géographique. Il permet aussi l’achat de la plupart des titres en e-book et l’abonnement des institutions et des particuliers à la lecture en ligne de livres (y compris de quelques autres éditeurs), vidéos, VOD et livres audio.






