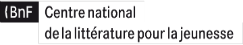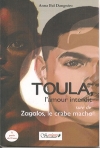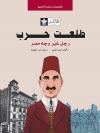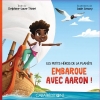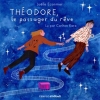Cette bibliographie témoigne d’une tendance : publier pour les enfants des livres mettant en valeur la « renaissance africaine », le rôle essentiel des Noirs dans la civilisation égyptienne, les figures marquantes comme Cheikh Anta Diop, la vision africaine de l’histoire… La publication en langues maternelles continue, que ce soit en éditions bilingues ou monolingues ; ainsi ici, en bassa, lingala, tamajaq et kinyarwanda. Fatou Keïta innove avec un album documentaire autour de l’initiation, À l’école du Tchologo ; les éditions togolaises Ago offrent deux bonnes BD ; Didier Kassaï signe un très grand album, Tempête sur Bangui ; le roman congolais La Guerre et la paix de Moni-Mambu « Kadogo » vient enrichir la littérature sur l’après-guerre des enfants soldats… : difficile de résumer la richesse de cette bibliographie double mars-juillet !
› Accéder à cette bibliographie
› Télécharger cette bibliographie au format PDF